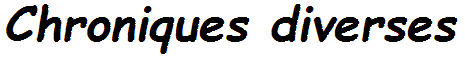Félix Laviolette, aubergiste de Saint-Eustache (1812-1863)
par Marc-Gabriel Vallières
Article publié dans La Feuille de Chêne, février 2025, pages 9-11.
Certains patronymes restent célèbres dans l'histoire d'une paroisse. Pourtant, même si on se souvient d'un ou deux personnages de cette famille, la grande majorité de ses membres demeurent pour nous des inconnus, même s'ils ont eu à leur époque un certain rôle social ou de la notoriété. Ainsi en est-il de Félix Laviolette, aubergiste et cabaretier pendant vingt-cinq ans sur la rue Saint-Eustache, tout juste après les événements de 1837.
Il faut d'abord rappeler qu'au début du XIXe siècle, même dans un village comme celui de Saint-Eustache, plusieurs familles pouvaient porter le même patronyme sans avoir un proche lien de parenté entre elles. C'est bien le cas de notre aubergiste Félix Laviolette, qui n'appartient pas à la même famille que le Pierre Laviolette qui devient en 1826 co-seigneur de la Rivière-du-Chêne en épousant Elmire, fille du seigneur Eustache-Nicolas Lambert-Dumont.
La première mention que nous avons de la famille de Félix dans la région est l'achat en 1797 par son père Joseph d'un emplacement tiré de la terre de Simon Hotte, le long de la rivière du Chicot, afin d'y installer une boutique de forge(1). Il est indiqué au contrat que l'acheteur Joseph Laviolette est déjà forgeron au Chicot. Il a vingt-six ans et il est encore célibataire. Nous ne savons pas s'il travaillait précédemment comme apprenti chez un autre forgeron ou s'il opérait une forge sur un emplacement loué. Six mois plus tard soit le 14 janvier 1798, il signe chez le notaire Gagnier de Saint-Eustache un contrat de mariage avec Pélagie-Françoise Prud'homme, fille mineure de 18 ans d'un habitant de Sainte-Rose(2). Ils se marient à l'église de Sainte-Rose le 22 janvier. Leur première fille Marguerite naît onze mois plus tard et est baptisée à la paroisse de Saint-Eustache. Entre 1798 et 1809, les six premiers enfants du couple y sont baptisés, dont trois qui décèdent en bas âge.
En 1811, Joseph Laviolette achète un emplacement au village de Saint-Eustache, au Nord de la Grand'rue en haut du Petit-moulin et y déménage sa forge. Cet emplacement correspond aujourd'hui à une partie du terrain situé du côté impair de la rue Saint-Eustache, entre le 301 et le 317 de cette rue, englobant le petit parc qui a aujourd'hui remplacé l'ancienne manufacture de voitures Brunelle(3). La famille s'installe à cet endroit et va y demeurer pendant plus de cinquante ans. C'est là que vont naître cinq autres enfants entre 1812 et 1819 dont Félix, le 29 juillet 1812.

Le site de l'auberge de Félix Laviolette
(photo MGV, 2017)
Félix Laviolette ne laisse aucune trace jusqu'à ses vingt-cinq ans. Le 24 novembre 1837, au moment même où non seulement le village de Saint-Eustache mais aussi toute la région est en effervescence, il s'engage comme apprenti auprès de l'aubergiste William Vart avec le rôle bien spécifique d'y « tenir le bar »(4). Vart est en fait un charpentier et un constructeur de moulins mais il a aussi loué une maison au village pour y tenir une auberge, probablement durant les périodes creuses de son travail.
Pendant ce même automne, Félix Laviolette se marie d'une façon qui a dû « faire jaser » à l'époque. En effet, issu d'une famille catholique, il épouse une fille de son âge mais qui provient d'une famille presbytérienne, Sophia Forbes(5). Elle est la fille d'un cultivateur de Lachine, John Forbes et d'Isabella Dingwall et elle a deux soeurs qui seront plus tard connues dans l'histoire de Saint-Eustache, Janet et Mary Ann. Leur mariage est célébré par le pasteur presbytérien de Saint-Eustache. Cependant, le parcours religieux de Sophia demeure insolite : leurs enfants seront baptisés à la paroisse catholique mais, quoiqu'elle se soit officiellement convertie par un baptême à la paroisse catholique(6) en 1845, elle est inhumée en 1854 en terre presbytérienne(7).
Les événements qui ont cours en décembre 1837 viennent modifier les activités au village. Le curé Paquin nous indique que Joseph Laviolette et son fils n'ont pas été compromis(8). En 1838 et 1839, Félix peut donc faire l'acquisition de deux emplacement au Nord de la Grand'rue, à proximité de celui de son père, dans une section du village qui n'a pas été détruite lors de la bataille. Il n'est pas certain s'il y établit immédiatement une auberge mais quatre ans plus tard le 7 mai 1842, il obtient de la Cour des Sessions de la Paix une « tavern licence » - un permis d'auberge(9).
Le couple a au moins huit enfants entre 1838 et 1850, tous baptisés à la paroisse catholique comme nous l'avons vu. Certains s'intégreront à la société francophone comme Marie-Jeanne, née en 1845 et qui épouse Théophile Paquette à Saint-Eustache en 1883, alors que d'autres iront vers la communauté anglophone comme Marie-Anne, née en 1847 et qui épouse Isaac Huckle en 1866 à l'église baptiste de Montréal.
Sophia Forbes s'éteint le 17 mars 1854 à Saint-Eustache, en pleine épidémie de choléra. Peut-être est-ce à cause de cette épidémie qu'elle est enterrée chez les presbytériens, malgré sa nouvelle appartenance à la foi catholique, mais il ne s'agit là que d'une hypothèse. Félix Laviolette demeure toute sa vie aubergiste au haut du village et y décède le 21 novembre 1863.
Les enfants de Félix Laviolette et de Sophia Forbes nous laissent une autre trace en 1877. Nous avons mentionné que Sophia Forbes et ses soeurs Janet et Mary Ann étaient les filles de John Forbes et d'Isabella Dingwall. Peu après la naissance de sa troisième fille, John Forbes décède et sa veuve se marie en secondes noces avec un écossais du nom de McNaughton. Ils ont un fils prénommé Donald qui est ainsi le demi-frère de Sophia, Janet et Mary Ann Forbes. Donald McNaughton devient un riche cultivateur à Saint-Eustache et possède une terre juste au Nord du village. Lorsqu'il décède en 1877, son testament stipule que la propriété de ses biens ira à son épouse Isabella Clark mais la jouissance de la ferme et des animaux ira à ses demi-soeurs célibataires Janet et Mary Ann et, après leur mort, à son neveu et ses nièces, enfants survivants de Félix Laviolette et de Sophia Forbes(10). Autre élément intéressant de ce testament, c'est d'avoir prévu des sommes pour les orphelins et le collège protestants, pour l'église presbytérienne de Saint-Eustache, mais aussi une somme pour les pauvres du village, devant être distribuée par Charles-Auguste-Maximilien Globensky, ainsi que pour son domestique!
Le souvenir de l'aubergiste Félix Laviolette et de son épouse Sophia Forbes a aujourd'hui été entièrement oublié. Tout le quartier où ils habitaient ayant été détruit lors de l'incendie du haut du village de Saint-Eustache d'avril 1910, nous ne pouvons même plus visualiser l'environnement dans lequel ils ont vécu. Seul témoin de cette époque révolue est la maison construite sur les ruines de l'incendie par Théophile Paquette et Marie-Jeanne, fille de Félix Laviolette et de Sophia Forbes, au 268 de la rue Saint-Eustache face à la Petite église presbytérienne.
________________
(1) Greffe du notaire Pierre-Rémy Gagnier, minute 2108, 8 juillet 1797, vente d'un emplacement par Simon Hotte à Joseph Laviolette, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), CN606,S11.
(2) Ibid., minute 2238, 14 janvier 1798, contrat de mariage entre Joseph Laviolette et Pélagie-Françoise Prud'homme.
(3) Cet emplacement est situé au haut du folio 573 au terrier 1800-1840 et correspond aux lots 172 à 174 au Cadastre du Village de Saint-Eustache de 1877.
(4) Greffe du notaire Stephen Mackay père, minute 2249, 24 novembre 1837, engagement de Félix Laviolette à William Vart, BAnQ, CN606,S31.
(5) Registres de l'église presbytérienne de Saint-Eustache, 29 novembre 1837, BAnQ, CE606,S63.
(6) Registres de la paroisse catholique de Saint-Eustache, 28 juillet 1845, BAnQ, CE606,S11.
(7) Registres de l'église presbytérienne de Saint-Eustache, op.cit., 20 mars 1854.
(8) Paquin, Jacques, « Tableau politique et statistique de la Paroisse de Saint-Eustache », dans La Revue des Deux-Montagnes, no 5, octobre 1996, page 59.
(9) « List of persons to whom certificates have been granted to obtain tavern licences in the District of Montreal for the year 1842 », BAnQ, TL36,S37.
(10) Trudeau, Jocelyne F., « Le testament de Donald McNaughton », dans La Feuille de Chêne, vol. 18, no 3, octobre 2015, pages 8-10.