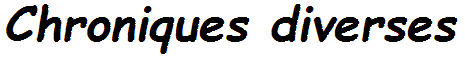Les cours de justice aux Deux-Montagnes
par Marc-Gabriel Vallières
Article publié dans La Feuille de Chêne, juin 2016, pages 4-5.
Que sait-on de l'histoire judiciaire du comté des Deux-Montagnes? Bien peu de choses! Bien sûr, nous avons tous vu des photographies anciennes du palais de justice de Sainte-Scholastique, aujourd'hui démoli. Celles et ceux qui ont suivi les célébrations du deuxième centenaire de la paroisse de Saint-Benoît, il y a quelques années ont peut-être entendu dire qu'il y avait eu, avant Sainte-Scholastique, une Cour de circuit à Saint-Benoît. Mais là s'arrêtent habituellement nos connaissances. Pourtant, bien avant ces deux paroisses, il y eut à partir de 1842 une Cour de division qui siégeait à Saint-Eustache. Qui l'eut cru? Voici un petit historique des cours de justice des Deux-Montagnes et des archives qui en ont été conservées.
* * *
L'administration de la justice dans les Laurentides commence en 1842 avec l'établissement des Cours de Division dans chacun des comtés. Avant cette date, la justice était centralisée à Montréal, chef-lieu du district judiciaire. Une «Cour de Division du district inférieur de Terrebonne» est alors créée et siège à Sainte-Thérèse, à Sainte-Anne-des-Plaines et à Saint-Louis de Terrebonne. Pour le comté de Deux-Montagnes, une «Cour de Division du district inférieur du lac des Deux-Montagnes» comporte cinq divisions, soit Saint-André-d'Argenteuil, Lachute, Sainte-Scholastique, Saint-Eustache et Grenville. La Cour de Division était un tribunal civil qui visait à rapprocher la justice des citoyens, pour les causes civiles relatives à des dettes de petites sommes (inférieures à quelques livres). Elle correspondait à peu près à l'actuelle Cour des petites créances. Un marchand qui avait des comptes impayés par ses clients pouvait se présenter devant cette cour pour obtenir un jugement et la saisie des biens du débiteur, si ce dernier ne pouvait s'acquitter de sa dette. La Cour de division ne sera que de courte durée, étant remplacée en 1844 par les Cours de Circuit de chacun des comtés. Des archives sommaires ont été conservées pour toutes les divisions mais ce qu'elles contiennent dépend de la division. Pour celle de Saint-Eustache par exemple, elles consistent principalement en des sommations à comparaître signifiées aux défendeurs. Dans le cas où les jugements ont résulté en une saisie des biens des défendeurs, une copie du bref d'exécution de la saisie a aussi été gardée. Mais malheureusement, aucun registre des jugements ni aucun plumitif (registre des procédures) ne semble avoir survécu. Pour la division de Sainte-Scholastique par contre, nous avons un plumitif, de même que les dossiers pour de nombreuses causes. Il nous est donc possible de savoir quel individu a poursuivi quel autre et, dans certains cas, quel montant a été saisi auprès du débiteur.

Le palais de justice de Sainte-Scholastique, construit en 1859 et démoli en 1926
(carte postale par Pinsonneault Frères, vers 1905, collection MGV)
En 1844, une «Cour de Circuit pour le circuit des Deux-Montagnes» est créée et son siège est établi cette fois à Saint-Benoît. Elle reprend la juridiction des quatre cours de division du district inférieur du lac des Deux-Montagnes pour les causes civiles monétaires mineures et siégera jusqu'en 1849. Le registre et l'index des jugements, le plumitif et les dossiers de ces causes ont été conservés. Une Cour de Circuit pour le circuit de Terrebonne est aussi établie en 1844 et les mêmes documents que pour Deux-Montagnes ont subsisté et ce, pour la même période. En 1850, la Cour de Circuit est réorganisée avec greffes à Saint-Benoît pour le comté des Deux-Montagnes et à Terrebonne pour le comté éponyme. Les mêmes types de documents que pour la période 1844-1849 existent pour la période 1850-1857.
En 1858, les tribunaux sont restructurés par districts judiciaires plutôt que par comtés. Le nouveau district de Terrebonne regroupe alors les comtés de Deux-Montagnes et de Terrebonne et le chef-lieu est établi à Sainte-Scholastique où un palais de justice et une prison sont construits. La Cour de Circuit fait place à la Cour de Magistrat qui comprend un volet civil et un volet criminel pour les petites causes (devenue par la suite la Cour Provinciale, puis la Cour du Québec). La Cour de Circuit et la Cour de Magistrat sont itinérantes, siégeant en de nombreuses localités du district, comme Saint-Jérôme, Sainte-Adèle ou Sainte-Agathe-des-Monts. La Cour Supérieure est établie pour juger les causes civiles et criminelles de grande envergure et la Cour du Banc du Roi ou de la Reine se voit attribuer les causes en appel (aujourd'hui la Cour d'Appel). En 1924, le chef-lieu est transféré de Sainte-Scholastique à Saint-Jérôme, où il se trouve toujours, et les activités judiciaires cessent dans le comté de Deux-Montagnes, mises à part les Cours municipales qui seront établies bien plus tard.

Le vieux palais de justice de Saint-Jérôme, construit en 1923 (photo MGV)
Pour revenir aux «petites cours» du comté durant la période 1842-1857, quels sont ceux qui y ont surtout recours? Les commerçants d'abord, qui se servent de ce nouvel outil pour récupérer les créances dues par leurs clients mauvais payeurs en ces temps difficiles de «l'après 1837» : James Watts et Étienne Dubrul, tous deux marchands à Saint-Benoît par exemple, ou Hortense Globensky, son mari Guillaume Prévost, et Noël Duchesneau, marchands de Sainte-Scholastique ou encore William Henry Scott et Jean-Baptiste et Isidore Proulx dit Clément, tous marchands de Saint-Eustache. De façon plus surprenante, on retrouve parmi les demandeurs plusieurs médecins qui ont recours aux tribunaux pour se faire rembourser les petites sommes dues par leurs patients, comme les docteurs James Bowie à Saint-Eustache ou Léandre Dumouchel à Saint-Benoît. Tout aussi surprenantes sont les causes intentées par les curés de Saint-Eustache, Saint-Benoît ou Sainte-Scholastique contre les paroissiens qui n'ont pas payé leur dîme ou leur «place de banc»! Assez curieux aussi sont les frères Joseph et Russell Twiss, horlogers de Saint-Paul-l'Hermite près de Joliette et vendeurs ambulants d'horloges «grand-père». Ils ratissaient les campagnes pour vendre leurs horloges aux cultivateurs qui refusaient par la suite de les payer lorsque le mécanisme faisait défaut!
Pour nous permettre de savoir qui de nos ancêtres ont été poursuivis ou ont eu recours à ces tribunaux pour être payés, une nouvelle base de données vient d'être ajoutée au site web Patrimoine-Laurentides. Dans la plupart des cas, les archives ne nous permettent pas d'avoir beaucoup de détails sur ces causes, mais ce nouvel index nous permettra au moins de savoir qui a poursuivi qui et, dans certains cas où une saisie des biens du débiteur a été ordonnée, le montant de la saisie. Pour effectuer des recherches (gratuites) dans cette base de données, cliquez sur le lien «Index des tribunaux» à la droite de la page d'accueil :