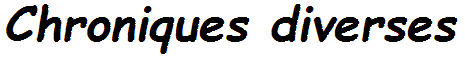Le développement de Saint-Eustache:
2. Rivière-Sud
par Marc-Gabriel Vallières
Article publié dans L'Éveil, le 17 mai 2003, page 12.
Comme nous l'avons vu dans la première partie, les terres de la Grande-Côte de Saint-Eustache, entre les rivières du Chêne et du Chicot, ont été entièrement concédées en 1739. C'est là le berceau du développement de la paroisse.
À partir des années 1750 et 1760, le développement va s'accélérer, principalement dans les côtes qui bordent les petites rivières. La côte située au Sud de la rivière du Chêne commence à être colonisée sur une grande échelle par une série de concessions qui ont lieu en 1755. Pour mieux nous situer dans le temps, rappelons qu'en cette même année 1755 commence en Nouvelle-Écosse la grande déportation des familles acadiennes.
À Saint-Eustache, les familles qui viennent s'établir à ce moment ne viennent pas d'Acadie mais de la région de Montréal. Certaines d'entre elles restent toujours présentes aujourd'hui dans la région, comme les Lauzon, les Éthier, les Brazeau et les Lafleur. Quelques terres sont d'abord concédées à la fin du mois de février à des habitants de l'île Jésus, tous déjà bien établis: Joseph Presseau, capitaine de milice, François Maisonneuve, aussi capitaine de milice, et enfin un noble, Germain Lepage de Saint-François. Ce dernier est le neveu de Louis Lepage de Sainte-Claire, seigneur de Terrebonne, qui agit à ce moment à titre d'agent seigneurial pour la concession des terres de la rivière du Chêne, pour le compte du seigneur Dumont.
Une seconde vague de concessions a lieu du 20 au 24 avril, toujours devant le notaire Coron, de l'île Jésus. Chose curieuse, tous les nouveaux habitants proviennent du même lieu, c'est-à-dire de la paroisse de Sainte-Geneviève, sur l'île de Montréal. Il s'agit de Joseph Biroleau dit Lafleur, Pierre Brazeau fils, François Charlebois, Gabriel Éthier fils de Joseph, Joseph Éthier, Pierre Éthier fils, François Lauzon fils, Michel Lauzon fils, Michel Rapidieu dit Lamer, Basile Turpin fils, Jean- Baptiste Turpin et Joseph Turpin.
À partir de ce moment, environ la moitié des terres situées le long de l'actuel chemin Rivière-Sud, entre l'autodrome 640 et la montée Laurin, sont occupées. Dans les années qui vont suivre, c'est-à-dire d'environ 1760 à 1780, la totalité des terres de cette côté sont concédées. C'est donc dire que lors de la construction de l'église du village de Saint-Eustache, au début des années 1780, tout le chemin de la Rivière-Sud est en bonne partie défriché, cultivé et habité par des familles.
Parmi celles qui s'établissent dans les années 1760, on retrouve les familles d'André Baulne, Nicolas Labonne, Louis Lalande, Antoine Larocque et Joseph Poitevin. On retrouve aussi plusieurs familles Rouleau, celles de Jean-Baptiste, Louis, Paul, ainsi que de François et Joseph, tous deux fils de Jean-Baptiste.
Parmi les familles qui s'établissent dans les années 1770, on retrouve celles d'Ignace Campeau, François Casal, Pierre Claude, Baptiste Lalande, Antoine Lahaie, Joseph Marleau, Toussaint Poirier dit Desloges, Paul Richer et Pierre Servant. Il ne restera par la suite à concéder que quelques continuations de terres, derrière celles déjà occupées.
Peu de témoins nous sont restés des premières années de la Rivière-Sud. Ce n'est que dans les années 1820 et 1830 que certains habitants deviennent assez à l'aise pour se faire construire des maisons de pierre, dont quelques-unes ont survécu jusqu'à nos jours. Prochaine chronique: Les premières familles de la côte Nord de la rivière du Chêne.